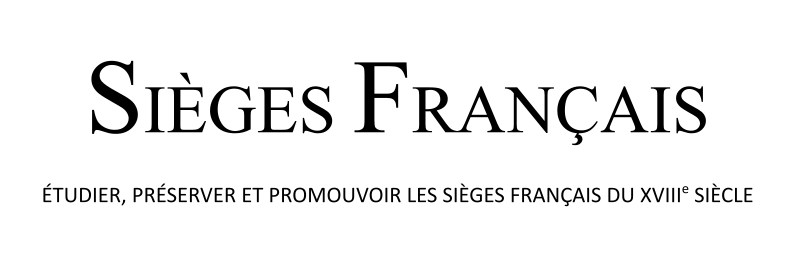La mémoire de la famille Turcot, dynastie d’artisans du bois active tout au long du XVIIIe siècle, souffre aujourd’hui de confusions en tout genre, les précédents auteurs spécialistes n’étant pas parvenus à s’accorder sur ses différents membres, leur estampille et leur profession respective. Dans les lignes qui suivront, nous tâcherons de clarifier l’histoire de cette famille.
Le père, Claude Turcot
Claude Turcot, fils de Jean Turcot, officier débardeur sur les ports[1], est le premier menuisier de la dynastie. Maître établis à Paris, rue Saint Nicolas[2] puis rue de Charenton[3], dans le quartier réputé pour sa densité d’ébénistes, il fut actif pendant les deux premiers tiers du XVIIIe siècle. Il produisit selon le style Louis XV des meubles en frisage ou en marqueterie géométrique monochrome avec rehauts de bronzes, bien proportionnés et mouvementés, privilégiant les bois de violette et de palissandre (fig. 1, 2). Il semble en avoir livré notamment pour son confrère marchand Pierre IV Migeon, qui contresigna quelques pièces qui nous sont parvenues.

Crédit photo : © Daguerre
Mais on trouve également dans la production de Claude Turcot des meubles de qualité bien plus commune, tels que tables, commodes et armoires en noyer massif, à la fabrication desquels concourrait son scieur de long, jusqu’à ce que soit prouvée la malhonnêteté de ce dernier[4]. En 1742, la confrontation de Turcot avec son ouvrier donne lieu à une violente agression. L’événement, qui sera relaté en précision par les époux, permet d’imaginer la scène (fig. 4). A la défaveur de sa notoriété, notre artisan n’utilisa son estampille « C TURCOT » (fig. 3) qu’en fin de carrière, justifiant le peu de pièces signées. De source archivistique, il nous est néanmoins renseigné qu’il utilisait une marque avant même l’obligation d’estampiller[5]. On perd trace de l’ébéniste dans le courant des années 1750.

La fortune du fils, Pierre-Claude Turcot (v. 17096-1782)
Dans le sillage de Claude Turcot, ses fils Pierre et Pierre-Claude devinrent menuisiers. Le premier, méconnu, semble avoir renoncé à la maîtrise en cours de carrière[7], et s’installa comme ouvrier libre rue de Charenton, dans le faubourg Saint Antoine. Peut-être y travaillait-il pour son frère aîné, Pierre-Claude.
Relations et prospérité
Ce dernier s’engagea en direction de la menuiserie en siège. Il fut reçu maitre le 23 juillet 1734[8], mais ne fera enregistrer ses lettres de maîtrise au Châtelet qu’en 1738[9]. Il s’établit même rue que son père et son frère[10], à l’enseigne « les Bons Enfants »[11], et se maria l’année suivante, en 1735. Les 1000 livres réunis à cette occasion par notre artisan rendent compte de finances modestes. Par la suite, on trouve Pierre-Claude Turcot chargé du rôle d’administrateur de la confrérie de la Sainte Vierge, distincte de la corporation des menuisiers-ébénistes, bien que fréquentée par nombre d’artisans du bois[12]. On élisait à ce poste l’organisateur des offices religieux et des activités solidaires, repas et fêtes notamment[13]. Certainement, par l’intermédiaire de ces événements, notre artisan put-il se familiariser avec plusieurs confrères, tels que Louis Delaitre, Nicolas Herissey, Jean-Pierre Latz et Mathieu Criaerd, ébénistes qu’il rencontra à la confrérie[14]. Le couple Criaerd, néanmoins, était déjà connu des Turcot[15].
En 1744, après dix années de maîtrise, Turcot prit à l’atelier Pierre Coutant comme apprenti[16], duquel on ne connaît rien. Nous n’en savons pas plus de Toussaint Fonbourg, qui a probablement aussi été formé à l’atelier de Pierre-Claude Turcot[17].


Crédit photo : © Fraysse & associés
En 1753, Pierre-Claude déménagea son atelier à l’angle de la rue Charonne et de la rue de Lappe (fig. 5)[18]. Il semble y être resté jusqu’à la fin de ses jours. C’est aussi dans le courant des années 1750 que Turcot paraît avoir commencé à s’investir dans les achats, la revente, la location et la sous-location de biens immobiliers du faubourg. Il résulte de ces investissements que la situation financière de Turcot devint plus confortable. Aux contrats de mariage d’au moins trois de ses enfants, il est en mesure d’avancer une dot de 2000 livres[19]. Aussi, ces opérations le mirent souvent en lien avec d’autres confrères ébénistes ou menuisiers. Son réseau professionnel, déjà étendu, fut donc encore étoffé.

Crédit photo : © Haynault


Mais ces relations étaient aussi durables : Turcot sera souvent choisi comme expert aux prisées des inventaires après décès de confrères ou de familles de confrères[20]. Parmi eux sont quelques ouvriers qui auraient bien pu être des collaborateurs ou sous traitants de Turcot : tels que Guillaume Lemelle, maître menuisier et marchand de bois[21], Jean Bourbon, scieur de long[22], Charles Lefèvre, menuisier en chaises de canne[23], et Pierre Orlia, maître sculpteur.
Fin de carrière
En 1761, à environ cinquante ans, notre menuisier est dit « en asséz bonne santé de corps allant et venant pour ses affaires »[24]. Néanmoins, prévenant, il rédige déjà son testament, avec un souci de justice et une grande confiance accordée à son épouse et à ses enfants. Sa femme en fera de même[25], témoignant par la même occasion d’une fervente dévotion : elle s’engage à céder 150 livres pour l’église de sa paroisse, afin que soient récités deux cents requiem à son intention et pour le repos de son âme. Ces précautions prises, Turcot fut en mesure de poursuivre son activité jusqu’en 1770. C’est à cette date qu’il renonce définitivement à l’artisanat. Son fond de commerce, rue de Charonne, est vendu au menuisier Bertrand-Alexis Chaumont, d’une famille que Turcot connaissait bien[26]. L’atelier contenait alors trois établis, utiles à autant d’ouvriers[27], l’outillage nécessaire et les gabarits des sièges : « quatre fauteuils servant de modèles, une chaise aussi servant de modèle ».
S’il garde encore quelques temps le statut de « maître menuisier »[28] et de « marchand de bois »[29], Turcot, désormais, se consacre pleinement à la gestion de ses biens immobiliers. Bientôt, il se désigne d’ailleurs dans les documents notariaux comme « bourgeois de Paris », affirmant sa réussite sociale. Il vécut encore suffisamment longtemps pour assister au mariage de l’une de ses petites filles[30], conjoncture rare pour l’époque[31]. Mais il décèdera quelques mois plus tard, le mardi 20 aout 1782[32], jour de la Saint Bernard[33]. L’inventaire de la maison, toujours à l’angle de la rue de Charonne, rend compte d’une situation plutôt confortable[34]. La propriété comprend une cour, deux chambres, un cabinet d’aisance, une cuisine et un grenier. Les pièces sont meublées de sièges divers, parfois cannés, de meubles en noyer massif auxquels sont à ajouter une petite commode en placage et une console en bois doré, les murs sont habillés de rideaux, de trumeaux et de grandes glaces. Quelques objets de verre, de faïence et de bronze s’ajoutent aux pendules pour occuper les plateaux et tablettes. Deux montres signées sont répertoriées dans les bijoux[35]. Enfin, trois tableaux répartis dans l’habitat, des huiles sur toile figurant la crucifixion, nous rappellent la piété certaine du couple Turcot.

Crédit photo : © Gros & Delettrez
Quelques éléments de la production de Pierre-Claude Turcot
Nous l’avons évoqué, les précédents biographes des artisans du XVIIIe siècle se sont parfois mépris sur l’identification des différentes estampilles de la dynastie Turcot. Il en découle qu’encore aujourd’hui, de manière très fréquente, certaines marques sont mal interprétées. Aussi a-t-on parfois confondu Pierre-Claude Turcot avec son père, autant qu’avec son fils ! Ainsi l’étude de l’œuvre connue de la dynastie Turcot est délicate, et doit être considérée avec beaucoup de recul. D’autant que nous avons également relevé de fausses estampilles.
La production connue de notre menuisier est d’une grande homogénéité stylistique, fidèle au style régnant dans la seconde moitié du règne de Louis XV, et témoigne ainsi d’une stabilité et d’un conservatisme ayant marqué plus généralement l’art du siège au XVIIIe siècle. Les meubles relevés sont généralement soignés mais sans originalité, de qualité courante. Un siège du corpus nous a néanmoins interpellés par sa singularité structurelle : une banquette faite de la jonction de deux cabriolets (fig. 7). Les lignes des ouvrages de Turcot sont toujours galbées, avec une faveur certaine pour les sièges légers en cabriolets, souvent cannés, à dossiers violonés, consoles d’accotoir à simple volute et bouts de pieds tronconiques. Le décor simple consiste systématiquement en une gorge moulurée, sculptée de fleurettes dressées aux sommets des pieds, au milieu de la ceinture et à la crête du dossier. Exception faite des chaises de commodité, pour lesquelles la caisse d’entrejambe reçoit une ornementation plus ample de fleurs et feuillages.

Crédit photo : © Christie’s

Crédit photo : © Copages Auction
Mais, comme son père avant lui, Pierre-Claude Turcot semble également avoir menuisé des meubles d’architecture. On lui a ainsi reconnu quelques armoires et buffets de chasse en noyer mouluré. Ce dernier type de meuble, pleine mode au milieu du siècle, était commercialisé par les plus grands marchand-merciers de l’époque, à l’instar de Lazare Duvaux[36].
Descendance de Pierre-Claude Turcot
Turcot laisse derrière lui six enfants[37] : Jean-Baptiste-Charles et Pierre-François devinrent marchand tapissiers respectivement à Versailles et place du Louvre à Paris, Pierre-Clément devint maître menuisier à Dijon, un second Pierre-François le fut rue Saint Antoine, après avoir été reçu maître le 11 septembre 1771[38]. Parmi les filles, toutes deux nommées Marie-Claude, la première épousa un marchand tandis que l’autre se maria à Pierre Orlia, que nous avons déjà évoqué, maître sculpteur rue de Charonne.
Le dernier Turcot
Il est encore une estampille que nous n’ayons pas évoquée, inscrivant « J · B · C · TURCOT » en cercle, mais dont la première lettre fut parfois mal lue et ainsi publiée (fig. 13). On a pu la rapprocher de plusieurs artisans de la dynastie Turcot, mais dont le prénom ne correspond en rien aux initiales de la marque. Aussi proposons-nous cette autre piste : celle de Jean-Baptiste-Charles.

Crédit photo : © Daguerre

Nous l’avons dis, ce dernier devint marchand tapissier place du Louvre, où il travailla notamment à garnir et vendre les sièges d’Adrien-Pierre Dupain[39], dont l’estampille est d’ailleurs curieusement ressemblante. Néanmoins, avant cela, le fils de Pierre-Claude Turcot fut maître menuisier[40], le temps de quelques années. Il fut reçu comme fils de maître, et fit enregistrer ses lettres de maîtrise au Châtelet le 20 novembre 1772[41]. C’est donc bien lui qui semble avoir frappé les traverses des très rares sièges que nous avons relevés, d’un style Louis XVI mature et sobre, parfois ornementés d’une sculpture singulière, et privilégiant la forme de dossier en médaillon (fig. 12).
Conscients de la brièveté de notre étude et de ses limites, nous espérons tout de même avoir éclairé la production et la carrière des quelques membres de la dynastie Turcot : l’ébéniste Claude, son fils menuisier Pierre-Claude et son petit-fils également menuisier Jean-Baptiste-Charles. Nous avons surtout insisté sur Pierre-Claude, qui, à la tête de son petit atelier, fut autant artisan qu’entrepreneur, s’enracina parfaitement dans son milieu, et fit réussite. Néanmoins, auteurs de meubles sans beaucoup de fantaisie ni d’apparat, certainement destinés à la classe bourgeoise[42], les Turcot sont restés discrets. Ce petit article aura permis de raviver, et de corriger, la mémoire de ces habiles artisans.
Xavier Sauty de Chalon
[1] Nous remercions vivement Monsieur Eric Detoisien pour la communication de ce renseignement, et des précisions qui suivent : Jean décéda le 6 mai 1727, et son épouse, Anne Auger, le 2 juin 1729. Claude avait au moins une sœur, Marie Anne Turcot, femme d’Adam Coconnier, menuisier, et un frère, Jacques Turcot, soldat dans le régiment des gardes françaises. Voir : Archives nationales, MC/ET/LXXII/255, 20 décembre 1730 : Notoriété.
[2] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/308, 25 juillet 1748 : Contrat de mariage de Jean Bourbon avec Anne Turcot.
[3] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/327, 23 juillet 1752 : Contrat de mariage de Pierre Carpentier avec Anne-Claude Turcot.
[4] Y//10988, 24 janvier 1742 : Plainte de Claude Turcot et sa femme. Document référencé dans : François de Salverte, Les Ébénistes du XVIIIe siècle : leurs œuvres et leurs marques, Paris : G. Van Oest et Cie, 1923, p. 310.
[5] Y//10988, 24 janvier 1742 : Plainte de Claude Turcot et sa femme. Claude Turcot reconnaît l’un de ses meubles volé et vendu par l’un de ses ouvriers, notamment du fait de sa « marque » : « En outre, led plaignant auroit fait vérifier la marque qui étoit encore sur le bois de lad. table avec la marque qui est sur celles qui font dans son chantier et se sont trouvés être les memes ». L’obligation d’estampiller ne sera décidée que l’année suivante.
[6] Nous proposons cette date à titre informatif, d’après la date de réception à la maîtrise de Turcot, et l’âge et la durée moyenne de la formation d’un menuisier au XVIIIème siècle. A l’époque, le début de la formation au métier de menuisier ou d’ébéniste se faisait en moyenne à 16 ans. Elle se composait d’une période d’apprentissage d’environ 6 ans, puis d’au moins 3 ans de compagnonnage. Ainsi était-on reçu maître menuisier aux environs de 25 ans. Or, comme nous le signalerons ensuite, Turcot est reçu maître en 1734, ce qui permet d’estimer qu’il naquit vers 1709. Voir : Steven L. Kaplan, « L’apprentissage au XVIIIe siècle : le cas de Paris », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1993, p. 451, 452 ; et : Eric Detoisien, « La maîtrise par brevet dans la communauté des menuisiers à Lyon au XVIIIe siècle », Histoires lyonnaises, septembre 2021, passim.
[7] En 1752, il est qualifié de « compagnon menuisier », mais n’est plus que « menuisier » en 1766. Voir : Archives nationales, MC/ET/XXVIII/327, 23 juillet 1752 (contrat de mariage de Pierre Carpentier avec Anne-Claude Turcot) et MC/ET/XXVIII/398, 21 avril 1766 (contrat de mariage de Louis Beloire avec Marie-Anne Turcot).
[8] François de Salverte, op. cit., 1923, p. 309. Nous devrons nous fier aux constats de Salverte, les registres des maîtrises et jurandes des métiers de la ville de Paris aux archives nationales étant manquants pour l’intervalle entre décembre 1693 et août 1735.
[9] Nous remercions vivement Monsieur Eric Detoisien pour la communication de ce renseignement.
[10] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/240, 5 septembre 1735 : Contrat de mariage de Pierre-Claude Turcot avec Marie-Jeanne Legrand.
[11] MC/ET/XXVIII/318, 9 septembre 1750 : Bail.
[12] Ainsi, l’ébéniste Louis Delaitre était également administrateur de la confrérie, en même temps que Turcot.
[13] David Garrioch, « Confréries de métier et corporations à Paris (XVIIe-XVIIIe siècles) », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 65-1, no. 1, 2018, pp. 95-117.
[14] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/268, 22 avril 1741 : constitution, et : MC/ET/XXVIII/278, 2 novembre 1742 : Fondation de messes.
[15] Y//10988, 24 janvier 1742 : Plainte de Claude Turcot et sa femme contre André Peschin et Gillier. La femme de Matthieu Criaerd témoigne en faveur de Claude Turcot, afin de renforcer ses accusations envers l’ébéniste Pierre Gillier.
[16] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/289, 22 décembre 1744 : Mise en apprentissage de Pierre Coutant, chez Pierre-Claude Turcot.
[17] En 1768, Pierre-Claude Turcot est le tuteur de Toussaint Fonbourg, qui a la même époque est dit compagnon menuisier. Il est donc probable que Fonbourg travaillait chez Turcot, d’autant que ce dernier fut présent au contrat de mariage de Toussaint. Or, à l’époque, il était de coutume pour un maître d’atelier d’être témoin au contrat de mariage de son apprenti. Voir : MC/ET/XXVIII/411, 23 septembre 1768 : Contrat de mariage de Toussaint Fonbourg avec Geneviève Guillard. Et : Marc-André Paulin, « Un maitre ébéniste du XVIIIe siècle, Mathieu-Guillaume Cramer », L’Estampille, Dijon : Editions Faton, n°341, nov. 1999, p. 57.
[18] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/496, 27 août 1782 : Inventaire après décès de Pierre-Claude Turcot. Les papiers répertoriés renseignent l’achat de la maison le 13 février 1753, pour 14 000 livres.
[19] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/367, 4 février 1760 : Contrat de mariage d’Antoine Pasquier avec Marie-Claude Turcot ; MC/ET/XXVIII/385, 21 octobre 1763 : Contrat de mariage de Pierre-François Turcot avec Marie-Anne Guerin ; MC/ET/XXVIII/439, 9 août 1773 : Contrat de mariage de Jean-Baptiste-Charles Turcot avec Marie-Anne Fouque.
[20] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/419, 15 février 1770 : Inventaire après décès de Barbe-Elisabeth Hébert (première épouse du menuisier Dieudonné-Grégoire Savard) ; MC/ET/XXVIII/419, 22 février 1770 : Inventaire après décès de Marie-Gabrielle Baudet (épouse de l’ébéniste Pierre Vilain) ; MC/ET/XXVIII/437, 21 avril 1773 : Inventaire après décès de Marie-Louise Fredet (épouse de Guillaume Lemelle, maître menuisier marchand de bois) ; MC/ET/XXVIII/465, 23 septembre 1777 : Inventaire après décès de Charlotte-Françoise Renou (seconde épouse de Dieudonné-Grégoire Savart).
[21] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/437, 21 avril 1773 : Inventaire après décès de Marie-Louise Frédet.
[22] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/308, 25 juillet 1748 : Contrat de mariage de Jean Bourbon avec Anne Turcot.
[23] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/308, 24 juillet 1748 : Compte et obligation par Charles Lefèvre.
[24] Archives nationales, MC/ET/XLII/474, 9 juin 1761 : Testament de Pierre-Claude Turgot.
[25] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/457, 11 août 1776 : Testament de Marie-Jeanne Legrand.
[26] Dès 1758, Turcot est en contact avec les Chaumont, il est même dit « ami » de Geneviève-Marguerite Chaumont à son Contrat de mariage. Voir : MC/ET/XXVIII/355, 8 janvier 1758 : Contrat de mariage de Jean-Baptiste Destroulleau avec Geneviève-Marguerite Chaumont.
[27] Bill G.B. Pallot, L’art du siège en France au XVIIIe siècle, Tours : ACR Edition, 1987, p. 50.
[28] MC/ET/XXVIII/465, 23 septembre 1777 : Inventaire après décès de Charlotte-Françoise Renou (dernière mention comme « menuisier »).
[29] MC/ET/XXVIII/437, 21 avril 1773 : Inventaire après décès de Marie-Louise Fredet (première et dernière mention comme « marchand menuisier »).
[30] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/491, 26 décembre 1781 : Contrat de mariage de Nicolas Millon avec Marie-Jeanne Pasquier.
[31] Maurice Garden et al., Le Vieillissement, Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1982, passim. Par ailleurs, on situe communément, pour le XVIIIe siècle, la durée de vie moyenne à la naissance à 30 ans, et à environ 50-60 ans pour l’adulte. Pierre-Claude Turcot, qui vécut plus de 70 ans, dépassa bien cette moyenne.
[32] Archives nationales, Y//14112 : Scellés de Pierre-Claude Turcot.
[33] Almanach royal, année 1782, Paris : Laurent d’Houry, 1782, p. 22.
[34] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/496, 27 août 1782 : Inventaire après décès de Pierre-Claude Turcot.
[35] Une montre d’ « Antoine Cocttos à Paris » dans sa boîte d’argent, et une autre de « Baillon à Paris » (certainement Jean-Baptiste III Albert Baillon) dans sa boîte d’or guilloché.
[36] Ce dernier vend en juin 1757 : « Un buffet en bois de chêne à trois tiroirs, verni avec fon marbre de Flandres, y compris les ports, 87 l ». Voir : Louis Courajod, Livre-journal de Lazare Duvaux marchand-bijoutier ordinaire du roy 1748-1758 : Précédé d’une étude sur le goût et le commerce des objets d’art au milieu du XVIIIème siècle, Paris : Société des Bibliophiles Français, 1878, vol. 2, n°2805.
[37] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/496, 27 août 1782 : Inventaire après décès de Pierre-Claude Turcot.
[38] Nous remercions vivement Monsieur Eric Detoisien pour la communication de ce renseignement.
[39] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/494, 28 mai 1782 : Délégation de paiement par Adrien-Pierre Dupain à Jean-Baptiste-Charles Turcot.
[40] Archives nationales, MC/ET/XXVIII/439, 9 août 1773 : Contrat de mariage de Jean-Baptiste-Charles Turcot avec Marie-Jeanne Legrand.
[41] Nous remercions vivement Monsieur Eric Detoisien pour la communication de ce renseignement.
[42] Nous n’avons identifié aucun des clients des Turcot. Seul un « particulier », mentionné en 1742, est passé à l’atelier de Claude Turcot pour lui acheter une table de noyer. Voir : Y//10988, 24 janvier 1742 : Plainte de Claude Turcot et sa femme.
Crédit photo : © Sotheby’s